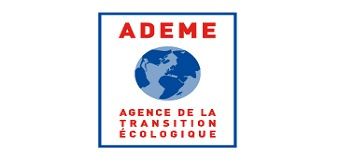Transition énergétique
Publié le 06 juin 2023 - Mise à jour le 02 juin 2025
Face à l’accélération du dérèglement climatique mais également aux inégalités d’accès à l’énergie, la transformation du modèle énergétique français est devenue l’un des défis les plus urgents de notre siècle. Fortes de leur vocation d’utilité sociale et de leur capacité d’innovation, les entreprises de l’ESS s’engagent et participent d’une transition énergétique sociale et solidaire, qui pourrait se révéler être une formidable opportunité pour l’ensemble des acteurs ! Un dossier réalisé en partenariat avec l'ADEME, l'Agence de la transition écologique.