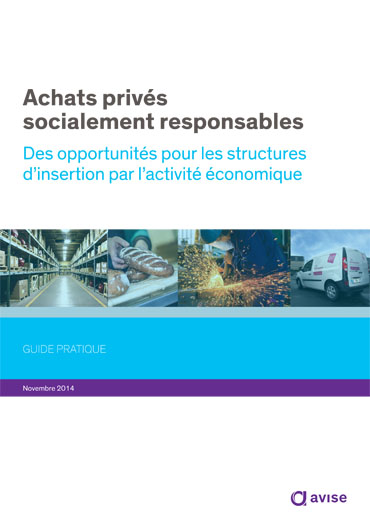Achats socialement responsables : histoire et contexte
Achats responsables : une inscription progressive dans la loi
L'inscription des problématiques d'achats publics responsables dans la loi française s'est faite progressivement.
L'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi est un enjeu qui apparait dans la commande publique dans les années 1990. C'est ensuite dans les années 2000 que cette notion nouvelle est formalisée sous la forme de « clauses sociales d'insertion » inscrites au sein des marchés. Les achats socialement responsables (ASR) dans la commande publique commencent alors à se développer.
1. Les premières expérimentations locales
Dans les années 1990, des collectivités territoriales expérimentent les « clauses du mieux-disant social » dans leurs appels d’offres. C’est le cas de la ville de Strasbourg et de la région Nord-Pas-de-Calais. Leur objectif : promouvoir l’insertion socioprofessionnelle de publics éloignés de l’emploi par le biais de la commande publique.
2. Une sécurisation dans le code des marchés publics
Entre 2001 et 2006, après une période d’incertitude juridique, les clauses sociales d’insertion telles qu’on les connaît font leur entrée dans le code des marchés publics. Des marchés réservés pour le secteur adapté et protégé apparaissent.
Suite à cette sécurisation juridique, les achats publics socialement responsables se développent en continu : alors que seulement 1,5 % des marchés publics supérieurs à 90 000 € HT intégraient une clause sociale en 2008, ils étaient 12,5 % en 2020, représentant 15,2 % du montant total des marchés publics (source : Guide sur les aspects sociaux de la commande publique, 2022).
La prise en compte des problématiques d'insertion sociale et professionnelle et la formalisation des clauses sociales d'insertion dans le code des marchés publics sont directement liées aux évolutions européennes.
1. La directive 2004/18/CE du Parlement européen du 31 mars 2004
Le code des marchés publics a évolué en France parallèlement à la législation européenne. En 2004, cette dernière précise la possibilité pour l'acheteur public d'intégrer des considérations sociales et environnementales au sein de ses marchés (directive du Parlement européen 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services).
En 2011, l’Union Européenne publie le guide Acheter social : un guide sur les appels d’offres publics avec clauses de responsabilité sociale pour expliciter la directive. Dès l’introduction, il est mentionné que les autorités publiques « peuvent favoriser les possibilités d’emploi, le travail décent, l’inclusion sociale, l’accessibilité, le commerce équitable en achetant judicieusement ». Ce guide a ensuite été mis à jour en 2021.
2. La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
En matière d’achats socialement responsables, l’Union Européenne donne également le ton. C'est d'abord la nouvelle ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 qui entrent en vigueur le 1er avril 2016 sur le fondement de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. Ils doivent être transposés par tous les États membres dans leur législation nationale.
Depuis le 1er avril 2019, le code de la commande publique, regroupant les textes législatifs relatifs à ce sujet, transpose la législation européenne et réglemente ainsi les marchés publics en France.
>> Pour en savoir plus, consultez la section relative aux clauses sociales d’insertion dans l’article « Achats socialement responsables : de quoi parle-t-on ? »
Les achats publics socialement responsables apparaissent avec la promulgation de la loi relative à l’ESS du 31 juillet 2014.
1. Les schémas de promotion des achats publics socialement responsables (SPASER)
L’article 13 de la loi relative à l’ESS de 2014 prévoit la mise en place de schémas de promotion des achats publics socialement responsables selon des modalités d'application précisées par son décret d’application publié en janvier 2016.
Désormais, les acteurs publics dont le montant annuel des marchés est supérieur à 100 millions d’euros hors taxe doivent obligatoirement adopter et publier ce schéma. Ce dernier intègre également des dimensions environnementales suite à la promulgation de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique.
2. 160 collectivités concernées
L’obligation concerne ainsi plus de 160 collectivités : la plupart des régions, une soixantaine de départements, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les communes dont la population est supérieure à 250 000 habitants. Des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) comme la SNCF et les entreprises publiques comme la Poste sont également concernés.
La ville de Paris, la RATP, le conseil régional d’Île-de-France ou encore celui de la Bretagne ont publié leur schéma de promotion des achats publics socialement responsables. Ces documents expriment notamment leurs ambitions en matière d’achats auprès des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) et des structures du secteur adapté et protégé.
>> Découvrez le SPASER de Paris
3. L'État poursuit l'effort
Face aux résultats mitigés de la mise en place des SPASER - seules 7% des collectivités concernées par l'obligation d'élaboration d'un SPASER en ont réalisé un - l'État tente de les promouvoir plus largement en abaissant le seuil de dépenses rendant leur mise en place obligatoire. La nécessité d'une administration exemplaire en matière de promotion des achats responsables est aussi réaffirmée.
La publication et l'entrée en vigueur du code de la commande publique le 1er avril 2019 permet alors le regroupement de l'ensemble des textes relatifs à la commande publique dans une démarche de simplification. Cela traduit la volonté de l'État d'encadrer et de promouvoir les achats responsables par le biais de l'outil législatif.
En septembre 2019, le Pacte d’ambition pour l’IAE est publié. Il a été élaboré par le Conseil de l’inclusion dans l’emploi. Issu d’un travail de concertation, ce document formule une proposition de feuille de route pour créer de 100 000 emplois supplémentaires en insertion d’ici la fin 2022. Pour atteindre cet objectif, plusieurs mesures ont été proposées, parmi lesquelles :
-
la justification systématique du non-recours aux clauses sociales par l’État pour tout marché dépassant un certain seuil de prestations horaires. Cette proposition avait pour ambition de faire des clauses d'insertion la règle et non l'exception ;
-
la création d'une académie de l'inclusion pour former les techniciens et les élus sur le sujet ;
-
le recours aux acteurs inclusifs pour la mise en place de filières d’économie circulaire et d’alimentation biologique dans le cadre du déploiement de lois sur ces sujets¹.
Le développement des achats responsables par les acteurs privés et publics
Au-delà de l'aspect législatif, les achats responsables se sont aussi développés grâce à l'engagement de différents acteurs publics et privés. Ils se sont non seulement investis pour l'application de la loi mais ont aussi encouragé le renforcement et le développement du cadre législatif par le biais de leurs initiatives d'achats responsables.
Dans le champ des achats privés, les entreprises ont d'abord tourné leurs politiques d'achats vers le secteur adapté et protégé afin de soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap. Elles ont ensuite progressivement ouvert leurs démarches aux structures de l’insertion par l'activité économique (SIAE) notamment grâce aux clauses sociales d'insertion intégrées dans les marchés publics.
1. La loi handicap
Historiquement, les structures du secteur adapté et protégé ont été les premières à bénéficier des achats socialement responsables du secteur privé, grâce à la promulgation de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, du 11 février 2005. Ce texte impose aux entreprises ayant atteint ou dépassé l’effectif de 20 salariés de totaliser au moins 6% de personnes reconnues handicapées au sein de leur effectif.
Pour réaliser cet objectif, la loi prévoit des alternatives au recrutement direct de personnes en situation de handicap : l'entreprise peut ainsi sous-traiter des marchés aux structures du handicap, telles que les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées (EA). Un pourcentage du montant de la facture de sous-traitance est alors déduit de la contribution due à l’AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, acteur de référence sur l’emploi et le handicap) en cas de non-respect du quota de travailleurs handicapés.
2. Les clauses sociales d'insertion
Progressivement, les entreprises s'intéressent à d’autres modalités d’achats que la sous-traitance auprès du secteur adapté et protégé.
Dans les années 1990 et 2000, de nombreux acteurs privés (notamment dans les secteurs du BTP, de l’environnement et de la propreté) découvrent les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) en répondant à des marchés publics intégrant des clauses sociales d’insertion. Le secteur de la propreté s'outille alors pour favoriser les collaborations entre entreprises « conventionnelles » et structures d’insertion à travers le site inserpropre.fr.
En 2020, près de 9 300 contrats de travail ont été signés dans le cadre de sous-traitance ou de co-traitance avec des SIAE visant à respecter les exigences des clauses sociales d’insertion (Alliance Villes Emploi, La clause sociale en 2020). Ceci constitue une légère augmentation par rapport à 2019.
>> Découvrez comment la RATP développe les marchés intégrant des clauses d'insertion
3. Le levier de la responsabilité sociétale
Depuis 2013, c’est surtout le développement des politiques de responsabilité sociétale (RSE) qui a ouvert le champ au renforcement des relations commerciales avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Ainsi en 2021, les dirigeants d’entreprises qui ont déjà établi des partenariats avec divers acteurs ont prioritairement pour objectif de renforcer l’ancrage territorial de leur structure².
Dans ce contexte, les acteurs privés cherchent à participer davantage au développement du tissu économique local, par le biais de la signature de chartes (charte de la diversité, charte Entreprises & Quartiers) ou par l’application de normes promouvant notamment les communautés et le développement local (ISO 26 000 par exemple).
En 2023, plus de neuf organisations privées et publiques sur dix sont engagées ou vont s’engager dans une démarche d’achats responsables. Pour les entreprises privées, la première raison de cet engagement est l’alignement avec la raison d’être et la politique RSE. Cette motivation est suivie par l’éthique et la satisfaction des attentes des clients³.
L'ANRU et le levier de la rénovation urbaine
Le développement des clauses sociales d'insertion et des achats socialement responsables sont directement liés à l'investissement du secteur public des travaux et de la rénovation urbaine sur les enjeux d'insertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté.
En 2003, le programme national de rénovation urbaine (PNRU) devient un levier essentiel pour la mise en œuvre des clauses sociales d’insertion dans les marchés de travaux. Ce programme a pris fin en 2020.
La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine donne naissance à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Sa mission est d’améliorer le cadre bâti des quartiers dégradés et des grands ensembles. Les investissements, très conséquents, portent sur des marchés de démolition, reconstruction et réhabilitation.
Cette loi prévoit l’adoption par l’ANRU d’une charte nationale d’insertion, intégrant dans le PNRU des exigences d’insertion socioprofessionnelle des habitants des zones urbaines sensibles (ZUS). Sur chaque projet de rénovation urbaine (PRU), les principes de la charte nationale d’insertion sont déclinés dans des plans locaux d’application (PLACI).
Des objectifs ambitieux sont fixés en matière d’insertion. L’ANRU prévoit en effet qu’au moins 5% des heures travaillées et 10% des embauches directes ou non effectuées dans le cadre de la gestion urbaine de proximité (GUP) soient réservées aux habitants des ZUS.
1. Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU)
En 2014, le nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) a confirmé la politique volontariste de l’ANRU pour les nouveaux chantiers en proposant une charte d’insertion aux objectifs similaires à la précédente programmation.
Ce nouveau programme détermine notamment la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville qu'il vise en priorité.
2. Les contrats de ville
Plus globalement, les contrats de ville, signés pour la période 2015-2020, intègrent de plus en plus les problématiques liées à l’insertion et à la commande publique responsable.
Ces schémas directeurs s’inscrivent en effet « dans une démarche intégrée devant tenir compte à la fois des enjeux de développement économique, de développement urbain et de cohésion sociale ». Ils prévoient notamment « l’ensemble des actions à conduire pour favoriser la bonne articulation entre ces projets et le volet social de la politique de la ville ».
L'engagement de l'État (à partir de 2008)
Dès 2008, l'État s'inspire des initiatives locales et initie sa propre démarche d'achats publics responsables.
A la suite du Grenelle de l’Insertion et s'inspirant des démarches des collectivités locales, l'État lance un plan « Administration exemplaire » avec pour objectif de développer une politique d’achats publics responsables dont les modalités sont exprimées dans la circulaire du 3 décembre 2008 : « les achats publics socialement responsables doivent représenter au minimum 10% des achats courants de l' État et de ses établissements publics d'ici à 2012 dans les secteurs comportant au moins 50% de main-d'œuvre ».
Le plan national d’action pour des achats publics durables 2015-2020 (PNAAPD) paru en 2014 fixe de nouveaux objectifs pour tous les acheteurs publics : l’État, les collectivités territoriales et les hôpitaux.
Il prévoit que « 25% des marchés passés au cours de l’année doivent comprendre au moins une disposition sociale ».
En 2019, 12,5% des marchés publics notifiés intégraient une considération sociale.
Objectif 2025 : « 30% des contrats de la commande publique notifiés au cours de l’année comprennent au moins une considération sociale ». (PNAD 2022 – 2025)
L’instruction n°5769/SG du Premier ministre du 17 février 2015 a imposé de nouveaux plans ministériels d’« Administration exemplaire » (PMAE) pour la période 2015-2020. Ils sont davantage axés sur l’environnement que les précédents mais intègrent également des aspects sociaux.
La direction des achats de l’État (DAE), dont l’objectif est de « définir la politique des achats de l’État sous l’autorité du Premier ministre », a par ailleurs défini les achats responsables comme un axe important de sa stratégie. Elle « promeut l’utilisation de clauses sociales favorisant l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi ou des personnes en situation de handicap avec l’aide des réseaux et structures locales ».
Afin d’outiller les acheteurs publics, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a été à l’initiative de la plateforme numérique Rapidd. Depuis 2016, elle rassemble la communauté des achats publics durables. Le Commissariat général au développement durable est en charge de sa gestion opérationnelle.
Le Commissariat général au développement durable anime également les réseaux territoriaux engagés dans une démarche d’achats durables. Les têtes de ces réseaux sont rassemblées au sein de l’Inter-réseaux « commande publique et développement durable ».
Sources :
¹ Pour l’économie circulaire : la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (dite « loi AGEC ») du 10 février 2020 ; pour l’alimentation : la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « loi Egalim ») du 30 octobre 2018
²Comisis-Opinion Way pour l’Observatoire des partenariats, Étude IMPACT-Entreprise, 2021, p. 60
³ L’Observatoire des Achats Responsables – ObsAR ,14ème baromètre des achats responsables, p.11 et 12
À voir aussi
Comment mettre en œuvre des partenariats pour l’emploi durable avec les entreprises du territoire ?
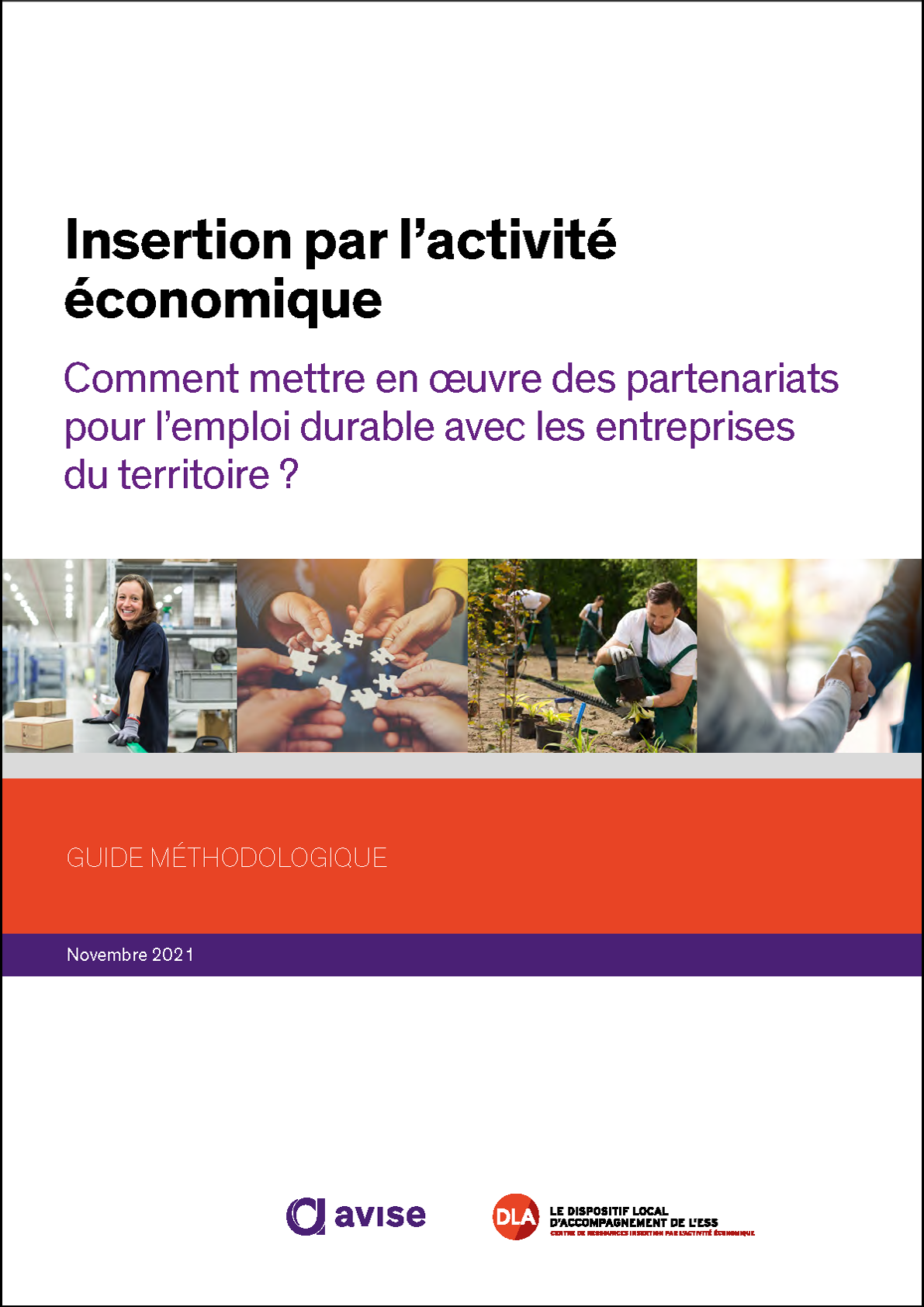
Développer les coopérations économiques avec les structures de l'économie sociale et solidaire
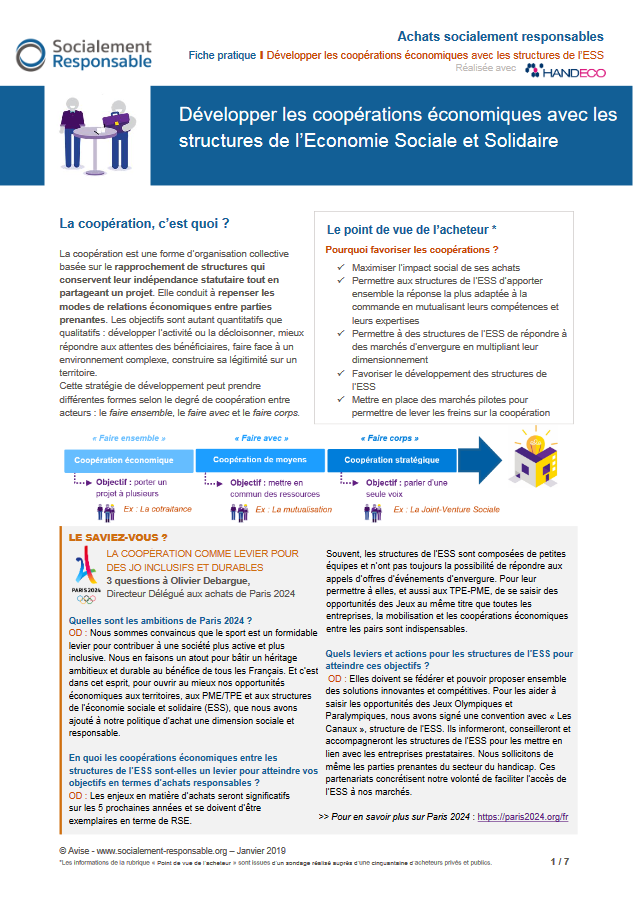
Mode d'emploi : Les achats socialement responsables
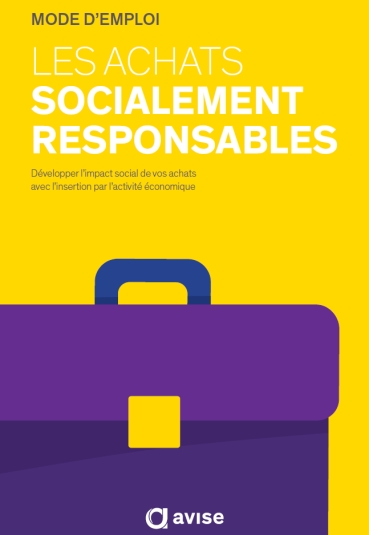
Achats privés socialement responsables et IAE