Définir ses indicateurs
Comprendre comment définir ses indicateurs
La majorité des évaluations d’impact social utilisent une combinaison d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Les informations qui alimentent les indicateurs sont des données objectives (situation factuelle), des données subjectives (perception de la personne qui répond) ou des données intersubjectives (perception de la personne interrogée, à propos d’une autre personne).
Pour définir vos indicateurs, il faut identifier, à partir de votre question, les informations à récupérer pour chaque effet à évaluer ainsi que la valeur cible que doit atteindre l’indicateur pour satisfaire les objectifs de votre projet.
Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur des indicateurs :
- standardisés, présents dans différents référentiels ;
- sectoriels, plus spécifiques à un type d’activité comme l’insertion par l’activité économique (taux de sortie positive) ou le recyclage des déchets (tonnes de déchets collectés) ;
- créés spécifiquement pour l’activité de la structure. Ils sont souvent inspirés d’autres indicateurs (standards, sectoriels ou précédemment créés par une autre structure) puis adaptés au contexte du projet (public concerné, moment de collecte de données…). Par exemple : nombre de chutes évitées pour les personnes âgées participant aux activités du groupe associatif Siel Bleu.
Méthodes standardisées, de quoi s’agit-il ?
La standardisation désigne la mise en place et l’utilisation d’une méthodologie préexistante et d’indicateurs de référence communs pour faciliter les analyses comparatives de projets. On peut citer : l’Impact Management Project, la base d’indicateurs IRIS, l’outil MESIS construit par la Banque des territoires, BNP Paribas et INCO. Si ces outils sont intéressants pour valoriser l’impact et s’ils favorisent le dialogue entre parties prenantes (notamment les financeurs), ils sont finalement difficilement utilisables pour réaliser des comparaisons. En effet, l'impact social de chaque projet dépend de son environnement.
L'évaluation sur mesure désigne, quant à elle, l’approche d’évaluation privilégiant l'analyse contextuelle et la prise en compte de la spécificité des projets (association des parties prenantes tout au long de la démarche, notamment). L’évaluation devient alors un outil au service de la compréhension des effets du projet et plus largement des mécanismes d’innovation des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). L’Avise présente cette approche dans ses publications méthodologiques dédiées au sujet.
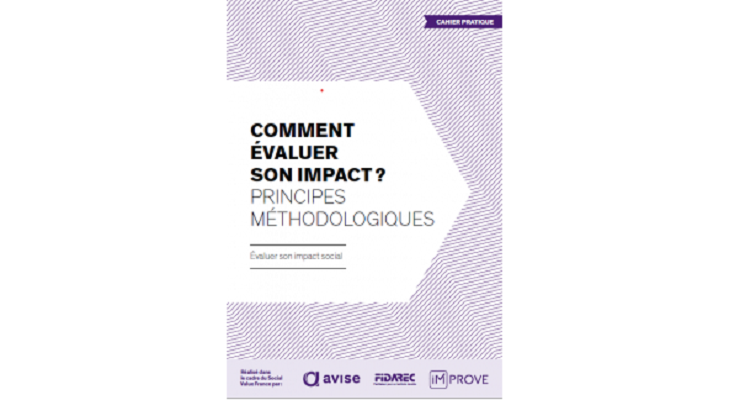
Le cahier pratique Comment évaluer son impact ? Principes méthodologiques propose une diversité de sections (type d’échantillon à constituer, type de données à collecter…). Ces sections permettent de choisir les principes méthodologiques les plus adaptés à la finalité de votre évaluation.
S'inspirer des référentiels existants
De nombreuses démarches d’évaluation ont été menées par des acteurs publics, des organisations non gouvernementales, des entreprises de l’ESS… Pour définir les indicateurs, la première étape est de vous inspirer de l’existant ! L’enjeu consiste ensuite à sélectionner parmi eux les plus pertinents vis-à-vis de votre question évaluative.
Deux types de référentiels peuvent être utiles à la construction d'indicateurs :
- les référentiels généralistes : les indicateurs proposés, souvent sur des enjeux ou thématiques larges, peuvent être appliqués à des projets très divers (égalité de genre, accès à l'éducation, travail décent, inclusion, biodiversité, etc.)
- les référentiels sectoriels : créés par des acteurs du secteur, ils ont pour objectif de proposer des indicateurs pertinents et adaptés à un secteur donnné.
Quelques référentiels généralistes
Les Objectifs de Développement Durable (ODD), développés par l'Organisation des Nations unies (ONU), offrent un cadre de référence avec des indicateurs de suivi pouvant servir de source d’inspiration dans sa démarche d’évaluation.
- La plateforme VALOR'ESS, créée en juin 2020 par l'Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes), est un référentiel d'indicateurs d'impact social en ligne et en accès libre pour valoriser l’impact de son activité. Depuis septembre 2023, la plateforme s'est enrichie d'un outil de bilan carbone simplifié, permettant à une structure de calculer les émissions de gaz à effet de serre de son activité de manière simple et intuitive et d'identifier des pistes d'amélioration.
Quelques référentiels sectoriels
Alimentation durable : pour évaluer l'impact d'un projet alimentaire le guide "Comment mesurer l'impact d'un projet alimentaire" (Syalinnov, 2019) propose des indicateurs en lien avec la durabilité.
- Art et culture : une boussole de l'art citoyen propose une série d'indicateurs permettant l'évaluation de projets culturels et artistiques, en lien avec la citoyenneté.
- Education : sur le sujet de l'égalité des chances, le référentiel partagé dans le rapport L'école ne peut pas agir seule (Impact Tank, 2024) propose plusieurs critères et indicateurs adaptés aux différentes parties prenantes (élèves, enseignants, parents etc.).
- Habitat : plusieurs thématiques font l'objet de référentiels, le référentiel sur les projets liés à l'habitat (Essec et Macif, 2025) offre une pluralité de critères et indicateurs ; la plateforme Commune Mesure dédiée aux tiers-lieux met à disposition des outils (dont des indicateurs) pour faciliter l'évaluation de leurs effets sociaux.
- Handicap : le guide méthodologique de l'Unapei (2022) propose des ressources pour construire son référentiel en intégrant les principes d'autodétermination et d'autoreprésentation des bénéficiaires.
- Numérique : parmi les thématiques en lien avec le numérique, celle de l'inclusion a fait l'objet d'un référentiel "Faire numérique ensemble" (Impact Tank, 2023)
- Sport : l'impact social du sport a fait l'objet de plusieurs référentiels comme L'impact social des actions d'insertion (Fédération nationale profession sport & loisirs, 2024), recensés dans un article "L'évaluation d'impact dans le secteur du sport" (Avise, 2024)

Intégrer des enjeux innovants : démocratie, genre, biodiversité, territoire. Cette publication valorise des retours d'expérience et boîtes et outils pour évaluer les changements complexes.
Prioriser les indicateurs pertinents
L'enjeu est de sélectionner les indicateurs les plus pertinents. Pour s'assurer de la pertinence des indicateurs choisis, deux bonnes pratiques :
1. Vérifier la robustesse de chaque indicateur
- L'indicateur contribue-t-il à répondre à la question évaluative ?
- L'information existe-t-elle déjà ?
- L'information est-elle facile à collecter ?
2. Tester les indicateurs auprès de vos parties prenantes
Il est fortement conseillé d'impliquer les parties prenantes dans cette phase, sous la forme par exemple d'un atelier pour définir les indicateurs en s'appuyant sur la cartographie des impacts.

Dans le guide Évaluer son impact social retrouvez : des clés pour choisir la méthode à mobiliser pour votre évaluation ; une présentation des types d’indicateurs ; une méthode pas à pas pour les définir ; des exemples de référentiels ; une méthode pour organiser votre collecte de données ; des conseils sur les principaux outils existants.
A voir aussi
À voir aussi
Cartographier les impacts et définir la question évaluative

Préparer mon évaluation d'impact

Démarches intégrées et démarches comptables

Évaluer mon impact environnemental
